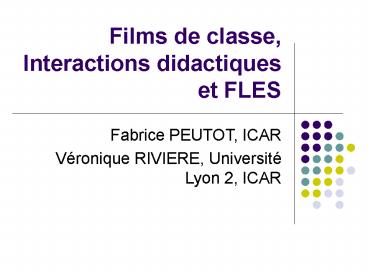Films de classe, Interactions didactiques et FLES - PowerPoint PPT Presentation
Title:
Films de classe, Interactions didactiques et FLES
Description:
Films de classe, Interactions didactiques et FLES Fabrice PEUTOT, ICAR V ronique RIVIERE, Universit Lyon 2, ICAR – PowerPoint PPT presentation
Number of Views:125
Avg rating:3.0/5.0
Title: Films de classe, Interactions didactiques et FLES
1
Films de classe, Interactions didactiques et FLES
- Fabrice PEUTOT, ICAR
- Véronique RIVIERE, Université Lyon 2, ICAR
2
Objectifs de latelier
- Présentation dune méthodologie de formation
basée sur lanalyse des traces de linteraction - Susciter interrogations dordre didactique (les
consignes en classe), méthodologique (rôle de
médiation des traces vidéo et transcrites, à
quelles conditions, intérêts, limites), réflexif
(quel dispositif de formation optimal, pour faire
quoi)
3
Caractéristiques générales de linteraction
- Fabrice PEUTOT
4
But de lanalyse des interactions
- Rendre compte de la manière dont les individus
entrent en contact dans des situations concrètes
et interagissent pour atteindre des objectifs
convergents ou divergents notamment à travers
le langage , Arditty, 2005 - Découvrir comment sont bâtis et interprétés les
messages échangés dans leur contexte
dinterlocution et dans le déroulement des
discours
5
Quelques définitions de linteraction
- Le Robert, 2000 une action réciproque
- Goffman, 1973, 23 par linteraction (ie
interaction de face-à-face), on entend à peu près
linfluence réciproque que les participants
exercent sur leurs actions respectives lorsquils
sont en présence physique immédiate les uns des
autres par une interaction, on entend lensemble
de linteraction qui se produit en une occasion
quelconque quand les membres dun ensemble donné
se trouvent en présence continue les uns des
autres le terme de rencontre pourrait
convenir aussi . - Vion, 1992, 17 Toute action conjointe,
conflictuelle ou coopérative, mettant en présence
deux ou plus de deux acteurs. A ce titre, le
concept recouvre aussi bien les échanges
conversationnels que les transactions
financières, les jeux amoureux que les matchs de
boxe . - Maingueneau, 1998, 40 toute énonciation, même
produite sans la présence dun destinataire, est
en fait prise dans une interactivité
constitutive, elle est en fait un échange,
explicite ou implicite, avec dautres
énonciateurs, virtuels ou réels, elle suppose
toujours la présence dune autre instance
dénonciation à laquelle sadresse lénonciateur
et rapport à laquelle il construit son propre
discours.
6
Typologie des interactions langagières
- Type dinteraction ou événement communicatif
(définis par critères externes), culturellement
spécifique - Evénement communicatif Kerbrat-Orecchioni,
2005, p. 71 un ensemble discursif plus ou
moins institutionnalisé dans une société
donnée . Ex la visite, lentretien, la
consultation médicale, la réunion de travail,
linteraction didactique - Notion de script ou de scénario prévisibilité
- Type dactivités (de discours en interaction, si
on parle dinteraction verbale)(définis par
critères internes) culturellement spécifique.
Ex la confidence, les salutations - Caractérisables par le matériel linguistique, les
catégories discursives (narration, argumentation,
description), les unités pragmatiques (actes de
langage) et ce que font les locuteurs - Prévisibilité /- gt négociation du cadre de
linteraction - Caractère co-construit, ou dinteractivité,
structure déchange
7
Exemple
- Un type dinteraction la consultation médicale
- Des types dactivité de discours en interaction
linterrogatoire, la confidence, la conversation,
la prescription, la salutation - Un ordre (succession ou imbrication des types
dactivité dans un type dinteraction) plus ou
moins fixe, qui peut faire lobjet de négociation - Une compétence communicative reconnaître le
type dinteraction et les types dactivités
discursives qui siéent à la situation et mettre
en œuvre les ressources linguistiques,
discursives qui correspondent, qui sont attendues
8
Linteraction didactique ses spécificités
générales
- Interaction asymétrique et contractualisée
- Différences de statut / de rôle / de temps de
parole - Notion de contrat didactique lensemble des
règles qui déterminent explicitement pour une
petite part, mais surtout implicitement, ce que
chaque partenaire de la relation didactique va
avoir à gérer et dont il sera, dune manière ou
dune autre, comptable devant lautre.
Brousseau, 1986 - Finalisée orientée vers un objectif
- Tous les niveaux de lorganisation de
linteraction didactique sont finalisés (des
valeurs et finalités de lécole jusquà chaque
question posée par lenseignant) - Ritualisée renvoie à lordre du cérémoniel
- Traits principaux répétitif , codifié, sacré
Kerbrat-Orecchioni, 2005 - Planifiée
- Préparation a priori de linteraction
- Planification en nombre, en ordre, en durée
9
Organisation hiérarchique
- Inscription supra
- Dépasse le temps situé de linteraction (les
programmes) - Linteraction comme unité dune séquence
- Notion dhistoire interactionnelle (Vion, 1992),
de dialogisme (Bakhtine, 1929) - Analyse séquentielle
- Organisation en unités de rang (Bouchard, 2005)
- La séance comme ensemble de subdivisions
activités, phases, épisodes, étapes
10
Exemple activités et phases
- 1-24 Installation / ouverture de la séance
- 17-125 Distribution du texte à lire à la
maison et écriture des devoirs - 84-298 Activité de lecture / compréhension
- 84-159 Phase de lecture individuelle
- 160-298 Phase dévaluation de la
compréhension, travail collectif, oral - 160-226 sous-phase questions de
compréhension - 226-298 sous-phase explication des mots
incompris - 298-806 Exercice de repérage des verbes du
texte - 298-329 Passation de la consigne collective et
recherche individuelle - 330-428 Rappel des trucs pour trouver le
verbe - 428-806 Mise en commun / corrections
- 806-1658 Exercices de tri, de recherche de
lépoque, dinfinitifs - 806-888 phase dexplicitation de la consigne
- 889-943 phase dorganisation matérielle
(déplacements délèves) - 943-980 phase de reformulation pour le groupe
de soutien - 981-1283 réalisation individuelle de
lexercice - 1265-1372 phase de correction
- 1373-1658 recherche collective de connecteurs
et de locutions adverbiales - 1659-1691 rangement et annonce dun événement
/ clôture de la séance
11
Exemple développement épisodique 1
- Phase 3 (mise en commun), Activité 2 (exercices
de repérage) - Procédé phrase par phrase
12
Exemple développement épisodique 2
Tours de parole Numéro dépisode Intitulé
428-431 E1 Consigne et rappel matériel
432-448 E2 Mobilisation des élèves sur la tâche
448-459 E3 Correction de la 1ère phrase du texte
460-526 E4 Correction du début de la 2ème phrase du texte
488-526 E4.1 Unité métalinguistique participe passé
527-563 E4.2 Correction de la fin de la 2ème phrase
563-681 E5 Correction de la 3ème phrase
628-681 E5.1 Unité métalinguistique verbe composé
652-660 E5.1.1 Linfinitif de avait préparé
687-711 E6 Correction de la 4ème phrase
712-765 E7 Correction de la 5ème phrase
734-765 E7.1 Unité métalinguistique participe présent
766-780 E8 Correction de la 6ème phrase
781-805 E9 Correction de la 7ème phrase
13
Organisation révélée/réelle entre planifié et
émergent
- En effet, si les interactions pédagogiques sont à
coup sûr planifiées, en tant quinteractions
sociales, elles donnent aussi à vivre aux
participants des phénomènes émergents,
c'est-à-dire non (entièrement) prévisibles,
échappant à la planification de lenseignant
maître des cérémonies. Ces micro-évènements sont
ouverts à linitiative du maître comme des
élèves. Cette indispensable autonomie de
lapprenant, en particulier, est dailleurs
largement thématisée dans les didactiques
contemporaines, à travers des notions comme celle
de centration sur lapprenant en didactique
des langues ou celle de dévolution en
didactiques des mathématiques et des
sciencesBouchard, Traverso, 2006 - ? dimension réflexive de lagir / praxéologique
- organisation a priori / on line / a posteriori
- a priori / programmé le cours est préparé
(activités, phases, ordre des phases) - on line / émergent le prof fait avancer son
questionnement en fonction de ce qui se passe
(épisodes et étapes comme unités secondaires ou
décrochées) - interaction didactique organisation pensée et
planifiée en amont, pendant laction, et a
posteriori pratique réflexive
14
Organisation locale
- Analyse conversationnelle
- ? Échange, intervention, tour de parole, acte de
langage - Interaction didactique polylogue inégal
ritualisé Bouchard 1999 - léchange ternaire
- le phénomène denchâssement
- les changements de cadre participatif (au niveau
de ladressage)
15
Léchange ternaire exemple
prof alors ce ne ne nous est pas dit exactement/ mais\ quest ce quil va FAIre Galilée ce jour là ? sollicitation par une question
prof oui/ ? distribution de la parole
élève il va observer le ciel ? réponse de lélève désigné
prof il va observer le ciel pour la première fois ? évaluation positive indirecte
prof avec sa fameuse/ ? sollicitation par une phrase à compléter
élève lunette ? réponse délève(s)
prof lunette\ ? évaluation positive indirecte
16
- Bon hier sil vous plait vous sortez vos
affaires je pense que cest déjà fait de toute
manière écoutez je ne sais trop de quel cours
vous arrivez là mais vous me paraissez
relativement bien dispersés pour linstant et pas
trop concentrés jespère que ça va sarranger
donc hier on a commencé une seconde partie dans
les mécanismes fondamentauxdes climats à savoir
latmosphère la circulation atmosphérique et nous
navons guère eu le temps que dévoquer la
composition de latmosphère vous ferez du
coupage du découpage et du collage à un autre
moment pour ceux qui ont pas eu le temps de
bricoler hier soir
17
- vous mettez sur votre cours une deuxième étape
qui consiste à évoquer les mouvements que lon va
enregistrer dans la troposphère le nom vous le
trouverez sans problème dans le document que je
vous ai donné hier donc pour linstantla
troposphèreen mouvement vous allez indiquer une
première phrase de présentation mais ensuite je
passerai à un croquis cette troposphère
c'est-à-dire la plus basse des couches de
latmosphère celle dans laquelle nous évoluons
tous les jours sans évidemment la nommer
18
- elle est agitée écrivez vous de mouvements
verticaux et horizontauxagitéede
mouvementsverticaux (écrit ces mots au
tableau).. et horizontauxau-dessous vous allez
tracer en laissant un petit peu de placede
manière à pouvoir écrireun trait horizontal qui
représentera le sol il vous faut cinq ou six
carreauxil vous faut quand même également de la
place pour écrire au dessous... je vais le mettre
plutôt à mi-hauteur le trait au tableau de
manière à ce que ça reste visible pour vous
sinonceux qui sont au fond ne verront rien du
tout.. - corpus Parpette, 2004
19
La polyfonctionnalité du discours de lenseignant
- Ces fonctions multiples font la richesse du
discours de lenseignant, présent sur tous les
fronts à la fois, mais elles lui confèrent aussi
une extraordinaire complexité sur laquelle il
convient de sinterroger. Ce nest pas tant
lexistence même de ces différents niveaux de
discours qui créent la complexité - et la
difficulté à les suivre pour les élèves
allophones que leur fonctionnement imbriqué. La
multiplicité de fonctions induit une construction
complexe par le fait que celles-ci opèrent
généralement de manière simultanée - expert de sa discipline, il apporte des
connaissances - chargé de faire acquérir des connaissances, il
met en oeuvre des procédures daide à
lapprentissage, à travers des consignes
dexercices, des questions de découverte, des
questions de vérification etc. - régulateur, il veille au bon déroulement de
lenseignement, organise la vie pratique de la
classe, rappelle à lordre - Parpette, 2004
20
Les changements de cadre participatif exemple
Prof classe maintenant on va se pencher sur cette image classe on
Fatma Fatma tu parles trop Fatma tu
classe on va se pencher un se pencher un peu sur cette image classe on
Mohamed bon/ on se calme/ Mohamed daccord ? Mohamed on !
Corpus Cortier/Peutot, 2005
21
Les transitions
- Analyse de larticulation des unités entre elles
- Exemple de transition longue
- le passage dune phase dexercice individuelle à
une phase de correction collective - ? enchâssement des unités /-
- Changement des modalités de travail
- Changement du cadre participatif
- Recatégorisation des rôles
- Différences de temporalité activités élève(s) /
activité profresseur
22
Transition longue
23
Transition longue
24
Les consignes dans linteraction didactique
- Véronique RIVIERE
25
Quelques idées circulantes sur les consignes
- Une consigne claire, compréhensible
- Discours écrit, monologal, monodirigé et activité
de lecture
26
Texte procédural
- Heurley, 1994, texte procédural
(psycholinguistique) ensemble organisé
dinstructions (voire de séquences descriptives)
spécifiant une ou plusieurs opérations ou actions
à accomplir et un but à atteindre. Lunité de
base du texte procédural est une instruction. - Veyrac, 2001, p. 79 (analyse du travail) les
consignes sont des objets de communication perçus
par un individu, dans un contexte particulier,
comme conçus par un prescripteur dans lintention
de faire réussir une tâche de façon optimale - Rivière, 2006, 19 (didactique des langues),
Prescription lexercice dune contrainte, plus
ou moins directe et plus ou moins forte, sur
lactivité de lapprenant en vue daméliorer ses
compétences langagières. Elle ressortit de la
fonction danimation et dinformation de
lenseignant, et, en tous les cas, constitue une
de ses prérogatives. Elle est lécho dun projet
porté par celui-ci et/ou par linstitution
éducative et donne en quelque sorte un format à
laction éducative. Rivière, 2006, p. 19 - Prescription un dire de faire ou de dire, un
dire quoi faire, un dire comment faire
(éventuellement un dire pourquoi/pour quoi faire) - Adam, 2001, genre dincitation à laction
discours ayant en commun de dire de faire en
prédisant un résultat, dinciter très directement
à laction
27
Les consignes, activité de représentation de
laction didactique
- De la planification de lenseignant (une activité
intentionnelle de discours). - Planifier un faire-savoir, un faire-faire
- Définition de lobjet de savoir
- Ancrage temporel
- Posture à adopter vis-à-vis du savoir
- Un exemple prototypique de représentation
oralographique la fiche de TP et la
verbalisation orale - Des actions situées (hic et nunc) de lenseignant
et/ou des apprenants - Des prédicats actionnels (verbes utilisés dans le
discours en interaction. Ex corpus devoirs - Une granularité plus ou moins fine des actions
- consigne-résultat,
- consigne-tâche
- Consigne-procédure
- Consigne de guidage
- Selon un ordre plus ou moins régulier
28
- Un partage/partition des actions (jai écrit/vous
allez lire) - Des fonctions diverses et spécifiques
polyfonctionnalité - Mouvement constant de polyfocalisation ( Olivia
tu nes pas obligée de la remettre ) vs de
monofocalisation ( tout le monde est prêt ) - A loral, des entours métacommunicatifs et
méta-actionnels de la tâche ( je vais vous
demander une chose , je vous explique , je
vais dicter le travail ) en forme dannonce, à
fonction denrôlement (Bruner) - Un algorithme de transformation (état
initial/état final étapes de transformation)
29
Les consignes, activité de communication
- Activité de communication
- Positions énonciatives
- Une composante pragmatique acte de langage
directif, force illocutoire ?? selon la fonction
didactique (injonction, tâche, définition,
procédure) - allez-y, Vous devez, il faut, vous pouvez, si
vous voulez - Interlocution régulation, intercompréhension,
négociation, adresse (cf. extrait 2, ref) - Hétérogénéité discursive (explication,
explicitation, définition, description - Dimension oralographique
- Rôle de la reformulation (cf. corpus)
- Lecture oralisée
- Adaptation au contexte
- Redondance informationnelle
- Spécification des tâches et leur contenu
- Simplification linguistique et cognitive
30
Les consignes, activité de cognition
- Support/activité de développement cognitif
- Outil de régulation de lactivité des apprenants
- Exemple fiche de TP bis (vidéo)
- vers la textualisation des observations durant
lexpérience - processus décriture sappuie partiellement sur
la reprise de la consigne écrite (qui représente
alors un prêt-à-écrire, une réponse
pré-construite, pour être en conformité avec les
attentes de P) et de la prise en charge orale de
la tâche (décrire phase type pour le HP) - Consigne écrite Étayage, évaluation,
enrôlement, référent
31
Travail en atelier
- Repérage de la manière dont
- Sont représentées les actions à réaliser ou
réalisées en temps réelle et selon quel grain - Sont communiquées les consignes (distinguer
tâche, procédures, énoncés méta, ) - Les consignes constituent un outil cognitif pour
lapprenant (quen fait-il une fois que
lenseignant a distribué les consignes)
32
Retour réflexif sur latelier
33
Les traces de lactivité interactionnelle
- Point de départ la situation
- Traces médiatisantes (plusieurs niveaux) entre le
professionnel et la situation de classe pour la
formation - 1) traces matérielles
- Le film de classe
- La transcription
- 2) traces intellectuelles
- Les concepts scientifiques et outils danalyse
- Notion de chaîne interprétative (Sautot,
Guernier, 2008)
34
Méthodologie de travail des traces de lactivité
- Chaque enseignant en formation propose à tour de
rôle un enregistrement et une transcription dune
séquence posant difficultés - Un objet de recherche-formation à déterminer
les transitions, les consignes, le cours dialogué - Notion de demi-boucle réflexive (Bucheton, 2011)
à mettre en place - Une question
- Le travail sur les traces
- Présentation de concepts
- Lecture des traces à la lumière des concepts
- Postures du ressenti et de jugement/posture
compréhensive où se situe lexpérience
35
Bibliographie
- Arditty J., Approches interactionnistes
exemples d efondemants théoriques et questions de
recherche, le Français dans le monde, Recherche
et applications n 42, 2005, CLE International - Sautot JP (éd), 2008, Le film de classe. Etude
sémiotique et enjeux didactiques. Lambert-Lucas - Rivière V., 2008, Dire de faire, consignes,
prescriptions Usages en classe de langue
étrangère et seconde. In Cuq J.-P., Davin-Chnane
F. (eds). Le Français dans le monde Recherches
Applications 44, 51-59, CLE International, Paris.
- Rivière V. (2006). Lactivité de prescription en
contexte didactique. Analyse psycho-sociale,
sémio-discursive et pragmatique des interactions
en classe de langue étrangère et seconde. Thèse
pour le doctorat en didactique des langues et des
cultures. Université Paris 3-Sorbonne Nouvelle. - Rivière V., 2005, Aujourdhui nous allons
travailler sur ou se mettre au travail en
classe de langue quelques aspects
praxéologiques des interactions didactiques. In
Cicurel F. Bigot V (eds), Le Français dans le
monde. Recherches et Applications, 38, 96-104,
CLE International, ParisRivière V. 2006 - Vinatier I., 2009, Pour une didactique
professionnelle de lenseignement, PURennes - Bucheton D., 2011, Le pouvoir réflexif et
intégrateur du langage en formation. Analyse
longitudinale dun dispositif de formation et de
ses effets, dans Bigot V. Cadet L., Discours
denseignants sur leur action en classe. Enjeux
théoriques et enjeux de formation, Riveneuve
Editions - Revue Pratiques, n 111-112, 2001, Les textes de
consignes - Revue Langages n 146, 2001, Les textes
procéduraux, Larousse.