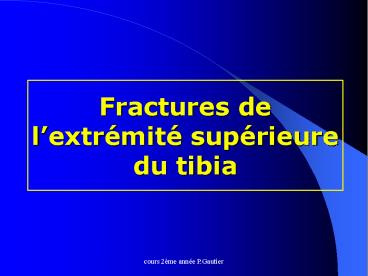Pr - PowerPoint PPT Presentation
Title:
Pr
Description:
Fractures de l extr mit sup rieure du tibia Fractures de l extr mit sup rieure du tibia Les probl mes sp cifiques D sorganisation des surfaces art par ... – PowerPoint PPT presentation
Number of Views:114
Avg rating:3.0/5.0
Title: Pr
1
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
2
(No Transcript)
3
Classification en fonction du mécanisme
Compression axiale
Fracture bitubérositaire Fr.
spinotubérositaires externes et internes
Compression latérale
Fracture-séparation externe et interne
Fracture tassement Fr mixtes
4
Fractures spino-tubérositaires
5
Fractures unitubérositaires
6
Fractures-séparation
7
(No Transcript)
8
Plaque AO Plaques de Bousquet
9
Fractures complexes
10
Fractures ouvertes utiliser des fixateurs
externes avec des broches dans les fragments
proximaux
11
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Les problèmes spécifiques
- Désorganisation des surfaces art par enfoncement
résiduel dun plateau tibial gt perturbation
grave du jeu art. - Désaxation globale du mb inf en varus (plateau
tibial int ) ou valgus (plateau tibial ext) - Le ttt doit répondre à 2 objectifs restauration
des surfaces art et redonner au mb inf un axe
normal
12
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Traitement chirurgical
- Relever la surface art enfoncée, puis la
maintenir par - ostéosynthèse /- greffon illiaque. Vis, plaque
vissée - Traitement orthopédique
- Méthode de traction mobilisation dans laxe
avec une broche transtibiale (lenfoncement nest
pas relevé, la mob est immédiate pour conserver
lamplitude art) traction mise en place 45-60
jours
13
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Dans tous les cas, mob doit être précoce, tjs
- réalisée pdt les 45 premiers jours dans le sens
- de la diminut des contraintes sur le plateau
- fracturé, afin de ne pas risquer de tasser la
- surface art relevée
14
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Rééducation après ostéosynthèse.
- Période dalitement courte, suivi de la pose
- dune attelle post.
- Phase de préconsolidation
- Verticalisation demblée permise déambulation
en décharge - Acquérir le plus vite possible lext active
complète (lattelle - est remise en place après les séances)
- Entretien art mob passive manuelle, puis
auto-passive, - arthromot
15
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Entretien art mob en décoaptation
fémoro-tibiale (par - traction dans laxe du segment jambier ou en
imposant une - contrainte varisante en cas de lésion externe,
valgisante en cas - de lésion interne) mob en piscine dès
cicatrisation - Entretien musculaire
- Lever dinhibition technique de facilitation
- Éviter toute R distale pour le QD
- Eviter toute composante de rotation et de
coaptation
16
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Rééducation après ostéosynthèse.
- Phase de remise en charge et dappui
- Vers le 75-90 ème jour
- Progression selon protocole de remise en charge
- Augmentation des sollicitations passives et
actives - Poursuite du W de gain damplitude, surtout fle
- Poursuite du W du QD IJ TS
- Travail des stabilisateurs latéraux (patte doie
en cas de lésion - du PT externe, TFL en cas de lésion du PT int)
17
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Rééducation après traction-mobilisation.
- Soins de lalité
- Massage à visée circulatoire, décontracturant
- Contractions statiques du QD technique de
facilitation - Mob du genou en passif doux dès J3 mob rotule
(les poids - de la traction sont laissés en place). Une
participation active - des fléchisseurs de hanche est demandée.(amplitude
30-40) - Mob en extension de hanche à partir du bassin
- Mob du pied antiéquin
18
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- La traction est enlevée vers S6, puis attelle
articulée ou - amovible gardée 1 mois
- Poursuite de la rééducation en continuant de
maintenir le - foyer de fr.
- Verticalisation avec précaution
- Programme de rééducation idem précédent puis
remise en - charge
19
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Déficit de flexion
- Adhérences intra-articulaires, rétraction des
parties molles - périart. (ailerons rotuliens)
- Mob sous AG
- Précoce 4-5 mois post fr.
- Manœuvre forcée, brutale faite après reprise
dappui et après - Consolidation
- W immédiat de recherche damplitude (manuelle,
mécanique) - antalgique cryoSETA massa antalgique
20
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Posture en fle extalternée toute les 3 heures
avec attelle, - Platre
- Mob par attelle motorisée à partir de J1 mob
de la rotule - Contracter relacher, stabilisation rythmique,
piscine - Physiothérapie antalgique
- Éveil musc. Avec W contre R
- W en force avec contractions statiques pour
limiter les - risques de réactions infl.
- Obtention du verrouillage actif du genou et ext)
TOTALE - ACTIVE
21
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Arthrolyse
- Section et résection de éléments périart.
- Libération du cul de sac sous quadricipital et
section des ailerons rotuliens - Libération des adhérences du QD
- La fle doit être plus facile
- Appui partiel ensuite puis total à J15
- !!! Récup du QD en force
- !!! Récup verrouillage actif du genou
22
Fractures de lextrémité supérieure du tibia
- Déficit dextension
- Eviter tout flexum
- Correction après un flexum de 3-4 mois par plâtre
- Ttt chir. Par allongement des IJ, désinsertions
des coques - condyliennes, libération de tous les éléments
post rétractés. - Massages décontracturants
- Mob en ext avec attelle, W du QD
- W des IJ à 6 semaines ( si intervention chir.)
- W fonctionnel vers J45 après sevrage de lattelle
post
23
Fractures de jambe
- Etiologie
- Ces fractures prédominent chez des sujets de 18 à
40 ans. - Elles se font le plus souvent par torsion (sport,
ski) ou par choc direct (circulation et travail). - Exceptionnellement on a des fractures isolées du
tibia ou des fractures isolées du péroné, mais le
plus souvent ce sont des fractures des 2 os de la
jambe. Les fractures sont parfois à des niveaux
différents. Il y a un point faible à l'union du
1/3 moyen et du tiers inférieur du tibia, qui
explique la prédominance des fractures à ce
niveau. Le tibia est courbe dans les 2 plans.
24
Fractures de jambe
- Les traits de fractures et les déplacements
- Fractures spiroïdes 50 des casFractures par
torsion le plus souvent diaphysaire basse. Le
péroné est fracturé plus haut. Il y a un biseau
supéro-interne qui menace la peau. - Parfois il y a un trait de refend qui peut isoler
un 3ème fragment en aile de papillon. - Il y a des spiroïdes courtes et des spiroïdes
longues (les longues sont plus stables) - Le déplacement se fait par chevauchement, le plus
souvent. Il tend à s'accentuer.
25
Fractures de jambe
26
Fractures de jambe
- Fractures transversalesElles succèdent à un choc
direct et peuvent se voir à tous les niveaux. Le
déplacement est variable. Cette forme peut être
stable après réduction, à moins qu'il n'y ait un
3ème fragment. - Fractures obliques courtesElles sont très
instables. L'ouverture cutanée peut se faire de
dedans en dehors. - Fractures comminutivesElles s'accompagnent de
lésions des parties molles et sont très
instables. - Fractures bifocales ou à double étageIl y a un
fragment intermédiaire de diaphyse qui risque
d'être isolé de la vascularisation. La
vascularisation intra-osseuse est en effet peu
importante et c'est la vascularisation
périphérique qui est prédominante et peut être
interrompue par la fracture et par le déplacement
27
Fractures de jambe
28
Fractures de jambe
- Fractures isolées du tibiaLe déplacement est
limité par l'intégrité du péroné. Le trait est
oblique et la réduction est difficile à maintenir
par un plâtre. Nombreux sont les partisans de
l'ostéosynthèse dans ces cas. - Les déplacements de toutes ces fractures
combinent angulation, translation, chevauchement,
et décalage (rotation).
29
Fractures de jambe
- Evolution
- La consolidation d'une fracture de la jambe bien
traitée se fait en 2 à 3 mois chez l'adulte, plus
rapidement chez l'enfant. On parle de retard de
consolidation au 4ème mois s'il n'apparaît pas de
signe de cal périphérique. - Les complications sont celles de toutes les
fractures diaphysaires
30
Fractures de jambe
- L'immobilisation des fractures sans déplacement
31
Fractures de jambe
- L'extension continue
32
Fractures de jambe
- La réduction sur cadre de TRILLAT suivie de
plâtre
33
Fractures de jambe
- La méthode de SARMIENTO
Elle permet un appui précoce dans certaines
formes de fractures. Le plâtre cruro-pédieux
initial est remplacé vers la 3ème semaine par un
plâtre de marche spécial. Cet appareil est
caractérisé par un moulage serré des masses
musculaires qui joueront le rôle de tuteur
compressif pour l'os. Les appuis sont bien
modelés au niveau des condyles fémoraux et du
tendon rotulien et de la rotule.
34
Fractures de jambe
35
Fractures de jambe
- L'ostéosynthèse à foyer ouvert
- Le vissage simple Les vis seules sont rarement
suffisantes, sauf dans les fractures spiroïdes
longues. Ce type de montage n'évite pas un plâtre
protecteur, mais il permet une excellente
réduction. - Les cerclages métalliques sont très insuffisants
pour les fractures de jambe (sauf pour les
spiroïdes) et ils ont été abandonnés. - Les plaques visséesElles permettent une très
bonne réduction et une bonne stabilité et évitent
le plâtreLes plaques ne sont plus utilisées pour
les fractures diaphysaires et elles sont
réservées surtout aux fractures des extrémités
36
Fractures de jambe
37
Fractures de jambe
38
Fractures de jambe
- L'enclouage centro-médullaire à foyer fermé
39
Fractures de jambe
40
Fractures de jambe
- Le clou verrouillé par des vis (KEMPF et
GROSSE) Les vis sont enlevées avant la
consolidation définitive, vers la 6ème semaine et
l'appui autorisé, ce qui stimule la formation du
cal. On peut verrouiller une extrémité du clou ou
les deux.
41
Fractures de jambe
42
Fractures de jambe
- En fonction du trait de fracture
- Les fractures transversales sont stables et
consolident bien avec le traitement orthopédique.
Ou place dun clou centro-médullaire avec appui
repris immédiatement. - Les fractures spiroïdes Le vissage associé à
une plaque vissée de neutralisation est adopté
par beaucoup. L'enclouage centro-médullaire peut
presque toujours être réalisé dans les fractures
spiroïdes.
43
Fractures de jambe
- Les fractures comminutives peuvent être enclouées
à foyer fermé verrouillage du clou en haut et
en bas par des vis transversales qui bloquent les
rotations et maintiennent la longueur correcte. - Les fractures à double étage enclouage à foyer
fermé avec petit clou d'alignement et
renforcer le montage par un verrouillage avec des
vis. - Les fractures isolées du tibia Ces fractures
peuvent être traitées par plâtre mais à condition
de surveiller l'absence de déplacement secondaire
(fréquent). ou enclouage centro-médullaire à
foyer fermé.
44
Fractures de jambe
- Fractures isolées du péronéElles sont dues à des
chocs directs. Elles consolident habituellement
sans réduction et sans ostéosynthèse au 1/3 moyen
ou nécessiter une réduction et une ostéosynthèse.
- L'extension continue peut permettre d'attendre
l'amélioration des conditions cutanées avant de
prendre la décision de faire une ostéosynthèse
(qui pourra se faire 2 à 3 semaines plus
tard).Le traitement antibiotique est
systématique
45
Fractures de jambe
- En fonction des lésions cutanées
- fixateur externe
46
Fractures de jambe
47
Fractures de jambe
- Traitement des pseudarthroses avec perte de
substance - osseuse
48
Fractures de jambe
49
Principes de rééducation
- Rééducation dès les premiers jours
- Prévention des phlébites, des raideurs et des
- Amyotrophie
- Pas de travail des releveurs contre R avant
- phase dappui partiel
- Travail du triceps contre R à la phase dappui
- total
50
Rééducation à la phase de non appui
- Bilan du Patient
- Recherche des troubles thromboemboliques,
dœdème, de - douleur sous plâtre
- Recherche des déficits sensitifs, musculaire,
articulaires - (parfois en équin), et musculaires (attention aux
prises au test qd, ij, ts)) - incapacités fonctionnelles marche
- Évaluation des secteurs non lésés.
51
Rééducation à la phase de non appui
- Traitement durant qq semaines
- Exercice actif des 2 chevilles anticoagulants
- déclive bas de contention
- Surélévation mb inf
- DLM cryothérapie
- Pressothérapie
- Surveillance du plâtre si besoin complications
cutanées - (escarre, sensation de brûlure), complication
circulatoire - (œdème distale, cyanose des orteils, phébite),
complication - neurologique (compression du SPE)
52
Rééducation à la phase de non appui
- Entretien des art libres du pied par
mobAnalytique - !!!! À ne pas mettre de R à la triple fle-ext
- Entretien art hanche pour éviter flexum
- !!! Rot (clou Centromédullaire non verrouillé)
- Balnéothérapie
- Lever de sidération W du verrouillage actif du
genou - PC antalgique cryo, SETA, pas dUS
- W de la marche avec 2 CA
- Travail proprioceptif par sollicitation manuelle
plantaire type - massage, travail sur balle de tennis
53
Rééducation à la phase dappui partiel
- Autorisé vers la 6ème 8ème semaine pour
- les fr. simples et vers la 15ème semaine pour
- les fr. ouvertes
- Autorisé à 1 mois post-op si fixateur de type
- Rigide
- Examen kiné cicatrice, mobilité, trouble de la
- trophicité
54
Rééducation à la phase dappui partiel
- Remise en charge plan incliné, balance, 2CA,
balnéothérapie et - travail de la marche
- Travail musculaire en CCF en piscine (en flexion)
- Travail du JA avec QD contre R croissante (assis)
- Travail contre R proximale du QD et IJ SETE
- Travail de la mobilité avec techniques
analytiques et spécifiques - de toutes les art de lavant pied et de la
médiotarsienne - (attention au contre prise pour la sous
astragalienne) - Massage de la cicatrice
- Travail sensorimoteur
55
Rééducation à la phase dappui total
- Objectif réduire les déficits et incapacités
- Examen pas de déficit du genou et de la hanche
- La mise en charge totale peut réactiver des
- phénomènes dl et infl oedeme
- Présence dun déficit musculaire, en force,
endurance - Présence dun déficit proprioceptif, dune
boiterie - dappréhension à la marche, montée et descente
- descaliers
56
Rééducation à la phase dappui total
- Traitement
- Gain damplitude de la cheville techniques
analytiques, manuelles, postures - Travail de tous les muscles du mb inf, avec R
manuelle, mécanique, SETE, en Cco, CCF avec
variations du nb de séries, répétitions. - DLM, cryo
- Étirement actif
57
Rééducation à la phase dappui total
- Travail sensorimoteur exo en charge
- partielle
- avec ballon de klein, puis en charge sur
- plan instable (appui unipodal)
- Travail de la marche déroulement du pas,
- longueur, rythme