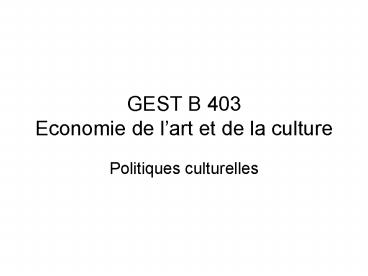GEST B 403 Economie de lart et de la culture
1 / 41
Title: GEST B 403 Economie de lart et de la culture
1
GEST B 403Economie de lart et de la culture
- Politiques culturelles
2
Précédemment
- Raisons dêtre des politiques culturelles
- Vision des économistes quant aux raisons de
subsidier la culture et quant aux modes de
subsidiation - Mais quid en pratique?
- Quid du découpage entre ? formes dexpressions
culturelles?
3
Pratiques
- Comparaison internationale?
- France, Belgique, Europe
- Historique des pratiques?
- Faits et chiffres?
- Quel niveau de pouvoir?
- Un constat comparaison internationale reste
compliquée de par les ? nomenclatures - Grandes différences entre monde anglo-saxon et
Europe continentale
4
France
- France, voir notamment Dijan (2005), Poirrier
(2006) - Historique dintervention remonte loin (Académie
Française, Comédie Française) - Création éphémère dun ministère fin XIXe
- Tentative de retour sous certains programmes
politiques durant les années 30
5
France
- Création réelle dun ministère des affaires
culturelles en 1958-59, sous de Gaulle,
ministère occupé par André Malraux - Mission rendre accessible les uvres capitales
de lhumanité, et dabord de la France, au plus
grand nombre possible de français dassurer la
plus vaste audience à notre patrimoine culturel,
et de favoriser la création des uvres dart et
de lesprit qui lenrichissent
6
France
- Malraux la culture sera gratuite
- Administration centrale puis petit à petit
création timide dantennes locales (comités
régionaux des affaires culturelles etc) - 60s création de maisons de la culture, vers une
décentralisation? - Sous Malraux marge de manuvre du ministre
large remise en cause après 1969
7
Décentralisation
- Décentralisation rapidement associée à
démocratisation (Saez, 2004) - Mais Menace pour la qualité?
- Saez (2004) deux régimes de décentralisation
- Décentralisation artistique ou culturelle
(atteindre un vaste public en garantissant la
qualité) - Décentralisation institutionnelle (procédures de
fonctionnement)
8
Décentralisation
- Décentralisation essentiellement culturelle
dans les années 1980, création des FRAC et FRAM.
Cogestion région-ministère - 1982 arrivée des DRAC (direction régionale des
affaires culturelles). - Plus récemment, renforcement de la
décentralisation
9
France
- Rôle des présidents et des ministres variable.
- Pompidou intérêt présidentiel marqué pour la
culture très ? de Valery Giscard dEstaing (Cf
Poirrier, 2005) - De 1959 à 2004, 14 ministres dont 2 seulement
tiennent plus de 4 ans Malraux et Lang
10
France
- Rupture avec larrivée de Jack Lang (1981), ?
quantitative des budgets (passage de 0,47 du
budget de létat à 0,76 puis à près de 1 en
1993) - Culture vue aussi sous son aspect
développement économique - Redéfinition de la mission
- Apparition des grands travaux
11
France
- Mission "permettre à tous les Français de
cultiver leur capacité d'inventer et de créer,
d'examiner librement leurs talents et de recevoir
la formation artistique de leur choix de
préserver le patrimoine culturel national,
régional, ou des divers groupes sociaux pour le
profit commun de la collectivité tout entière
de favoriser la création des uvres d'art et de
l'esprit et de leur donner la plus vaste audience
de contribuer au rayonnement de la culture et
de l'art français dans le libre dialogue des
cultures du monde."
12
Grands travaux
- Ces projets, qui concernaient tous les domaines
de la culture, de la musique à la lecture en
passant par les arts plastiques ou le savoir
scientifique et technique, situés en
Ile-de-France et en région, allaient offrir aux
meilleurs architectes de notre temps une occasion
unique d'exprimer leur talent. (Source
Ministère de la culture français)
13
France
- Fin années 1980, premières critique du tout
culturel (Finkielkraut) - Début des années 1990 constat né dune analyse
des pratiques culturelles ? échec de la
démocratisation (pour les cultures
classiques ) constat vérifié
jusquaujourdhui - Vaste débat et critique de létat culturel
(Fumaroli), culture ? affaire individuelle
14
Belgique
- Voir notamment De Wasseige (2000) ou les
documents disponibles sur les sites suivants - Observatoire des politiques culturelles
- http//www.opc.cfwb.be/accueil.asp
- Portail Culture.be collaboration entre les
Services de la Direction générale de la Culture,
la Cellule Internet du Secrétariat général du
Ministère de la Communauté française et lETNIC
(Entreprise des Technologies Nouvelles de
l'Information et de la Communication).
http//www.culture.be/
15
Belgique
- Histoire des niveaux dintervention suit
lévolution institutionnelle du pays - Chronologie détaillée (De Wasseige, 2000,
Communauté française, 2004) - Années 1970 gt autonomie des communautés
linguistiques, loi du 21 juillet 1971, inventaire
des matières culturelles relevant des
communautés. Depuis renforcement du rôle des
communautés - Essentiellement communautaire mais
16
Belgique
- Etat fédéral ESF mais aussi impact indirect via
la fixation déléments tels que la TVA, droits
dauteur, la législation sociale etc - Régions tourisme, monuments et sites,
aménagement du territoire et indirectement
politique de lemploi - Mais aussi villes, communes, provinces
17
Belgique
- Complexité institutionnelle gt nécessité de
coordination entre instances - Pas aisé à mettre en uvre
- Difficulté de chiffrer ce que chacun consacre à
la culture - Plus récemment, mise en place en 2004 détats
généraux de la culture
18
Belgique
- Etats généraux de la culture principes
générauxPenser une refondation de
lintervention publique dans le secteur culturel
motive la tenue dEtats généraux de la culture.
Son organisation doit être garante du recueil
de la diversité des opinions qui seront
exprimées.Son organisation doit aussi garantir à
chacun de pouvoir sexprimer.Les différentes
étapes du processus devraient permettre la
formulation, in fine, dun recueil de
propositions concrètes qui seront mises en débat
au Parlement de la Communauté. - Voir http//www.forumculture.be/home.php
19
Etats généraux
- Rédaction en 2005 dun document précisant les
Priorités CULTURE - Suggestion chiffrées dactions vues comme
prioritaires - Croissance annuelle espérée du budget affecté à
la culture de 5 à 10 millions - Mise en place dun système dévaluation publique
annuelle
20
Europe
- Etude EC 2003 secteur culturel et créatif près
de 650 000 millions , au total près 2,6 du PIB
de lEurope - Le produit intérieur brut (PIB) ? valeur totale
de la production interne de biens et services
dans une zone géographique donnée au cours d'une
année donnée.
21
Europe
- Comparaisons compliquées car les classifications
nationales ne sont pas harmonisées (Eurostat
dépend des pays pour linput des données) - Politiques publiques différences de
responsabilités entre pays (niveaux de pouvoir) - Tentative de chiffrer le support et laide directe
22
(No Transcript)
23
Comparaison
- Montants absolus pas nécessairement pertinents
- Compris entre 0,5 et 1 du PIB
- Grandes disparités nationales si on regarde en
termes de dépenses publiques par habitant (de 15
pour la Bulgarie à 234 pour lAutriche)
24
Europe?
- Culture compétence récente de lUnion européenne
(Traité de Maastricht 1992 et Traité dAmsterdam) - MAIS culture toujours du ressort des Etats
membres, intervention européennes relevant du
principe de subsidiarité (aides complémentaires à
des initiatives propres) (Vincent et Wunderle,
2006)
25
Europe
- Interventions dabord sur base de secteurs
(création et coopération artistique, puis domaine
du livre et de la lecture, domaine du
patrimoine). - En 2000 regroupement dans un programme-cadre
Culture 2000 - Maintenant, lancement des appels pour le
programme-cadre Culture 2007 (2007-2013) - En // intervention possibles dans le cadre
dautres programmes (Interreg, Leader, Regis)
26
USA
- Méfiance historique vis-à-vis de lintervention
de létat (Cf précédemment) - Au total aide fédérale inférieure aux dépenses
des états mêmes - Montants moyens par habitant au total de lordre
de 5 en 1997 (6 en 1998) - Aide fédérale fortement variable et dépendante
des autorités en place
27
Evolution finances aux USA
Source Martin, Neivert e.a. (2003)
28
Evolution en France
Source Budget 2007 Ministère de la Culture et de
la Communication français
29
Evolution en Belgique
Source Paque, Deschamps (2004)
30
Evolution en Belgique
Source Paque, Deschamps (2004)
31
Quel type dart et de culture
- Existe-t-il des domaines à privilégier pour une
raison ou une autre? - Mode de classification? Une indication des
politiques? - Quelle répartition observe-t-on en pratique?
- Communauté française répartition en 5 catégories
32
Communauté française
- Catégories
- Affaires générales
- Arts de la scène
- Jeunesse et éducation permanente
- Livre et lettres
- Patrimoine et arts plastiques
- Quel pourcentage pour chacun? (en 2004)
33
En France?
- Ministère de la culture et de la communication,
distinction entre - Mission culture
- Programme patrimoine
- Création
- Transmission des savoirs et démocratisation de la
culture - Mission médias et cinéma
34
Répartition équilibrée?
Source Budget 2007 Ministère de la Culture et de
la Communication français
35
Source Budget 2007 Ministère de la Culture et de
la Communication français
36
Quel type dart?
- Performing arts années 1960, inquiétude par
rapport aux besoins apparemment croissants (et
des demandes croissantes) des théâtres à Broadway - Fondation Ford charge deux économistes (William
Baumol et William Bowen) danalyser la situation - Approche déconomiste centrée sur la notion de
gain de productivité
37
Modèle (Loi?) de Baumol et Bowen
- Spectacles vivants peu de gains potentiels en
termes dinnovation ? reste de léconomie - Salaires dans les ? secteurs sont alignés
- gt pour les arts vivants, ? coûts (car salaires
sadaptent) non compensés par des gains de
productivité - gt Répercussion financière sur le prix du billet
? ou nécessité de subsides
38
Modèle (Loi?) de Baumol et Bowen
- Tests empiriques
- Dordinaire confirment la loi (avec quelques
exceptions) - Analyses montrent que les prix des spectacles
évoluent rapidement que linflation mais aussi
que laugmentation des coûts! - gt validation pour une concentration des subsides
pour le spectacle vivant?
39
Critiques
- Alignement des salaires?
- Augmentation des coûts et des billets est-elle
insurmontable gt si augmentation de productivité
et augmentation générale des salaires alors
billet pas forcément plus cher en termes relatifs - Action de létat cependant variable entre pays
40
Réalités
Cité dans Seaman (2002)
41
Quel type dart?
- Musées Arguments historiquement mis en avant ?
éducation et coûts moyens décroissants
(Smolensky, 1986). - Education quid de bonnes copies?
- Coûts moyens décroissants ? à demander des
subsides pour ne pas avoir une occupation
sous-optimale et garantir la rentabilité. Non
pertinent daprès Van der Ploeg (2005) car
existence dalternatives de gestion! - Mais bien sûr, valeur doption et autres (Cf plus
haut)